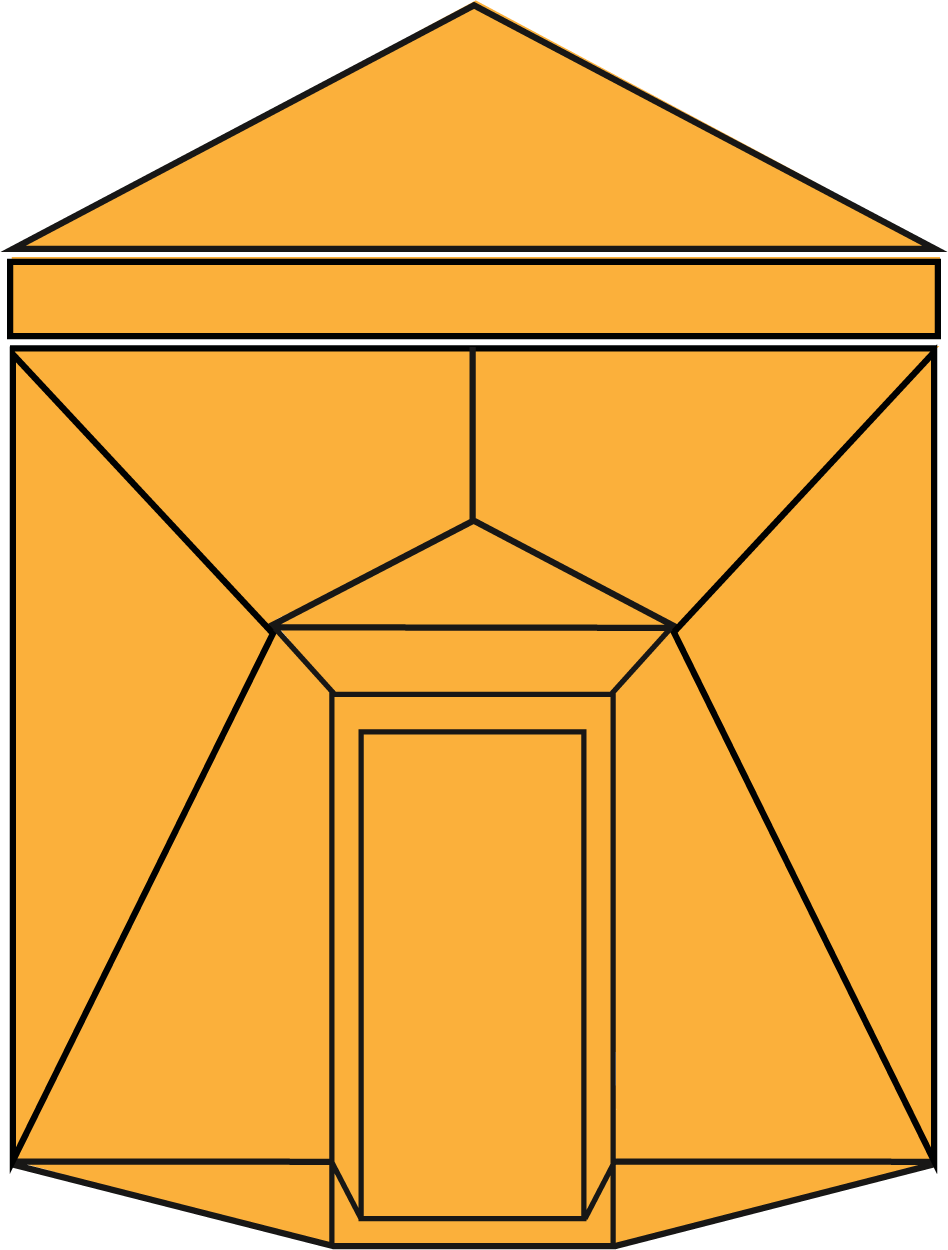5 : Une Espérance collective
Éphésiens 1,18 : « Qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints ».
Spe Salvi
14. Le père Henri de Lubac, en se fondant sur la théologie des Pères dans toute son ampleur, a pu montrer que le salut a toujours été considéré comme une réalité communautaire. La Lettre aux Hébreux parle d'une « cité » (cf. 11, 10.16; 12, 22; 13, 14) et donc d'un salut communautaire. De manière cohérente, le péché est compris par les Pères comme destruction de l'unité du genre humain, comme fragmentation et division. Babel, le lieu de la confusion des langues et de la séparation, se révèle comme expression de ce qu’est fondamentalement le péché. Et ainsi, la « rédemption » apparaît vraiment comme le rétablissement de l'unité, où nous nous retrouvons de nouveau ensemble, dans une union qui se profile dans la communauté mondiale des croyants.
Il n'est pas nécessaire que nous nous occupions ici de tous les textes dans lesquels apparaît le caractère communautaire de l'espérance. Restons dans la Lettre à Proba, où Augustin tente d'illustrer un peu cette réalité connue inconnue dont nous sommes à la recherche. Le point de départ est simplement l'expression « vie bienheureuse ». Puis il cite le Psaume 144 [143], 15 : « Bienheureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu ». Et il continue : « Pour faire partie de ce peuple et que nous puissions parvenir [...] à vivre avec Dieu pour toujours, “le but du précepte, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère” (I Tm 1, 5) ». Cette vie véritable, vers laquelle nous cherchons toujours de nouveau à tendre, est liée au fait d'être en union existentielle avec un « peuple » et, pour toute personne, elle ne peut se réaliser qu'à l'intérieur de ce « nous ». Elle présuppose donc l'exode de la prison de son propre « moi », parce que c'est seulement dans l'ouverture de ce sujet universel que s'ouvre aussi le regard sur la source de la joie, sur l'amour lui-même – sur Dieu.
16. Comment l'idée que le message de Jésus est strictement individualiste et qu'il s'adresse seulement à l'individu a-t-elle pu se développer ? Comment est-on arrivé à interpréter le « salut de l'âme » comme une fuite devant la responsabilité pour l'ensemble et à considérer par conséquent que le programme du christianisme est la recherche égoïste du salut qui se refuse au service des autres ?
17. Jusqu’aux temps modernes, la récupération de ce que l'homme avait perdu dans l'exclusion du paradis terrestre était à attendre de la foi en Jésus Christ, et en cela se voyait la « rédemption ». Maintenant, cette « rédemption », la restauration du « paradis » perdu, n'est plus à attendre de la foi, mais de la relation à peine découverte entre science et pratique. Ce n'est pas que la foi, avec cela, fût simplement niée : elle était plutôt déplacée à un autre niveau – le niveau strictement privé et ultra-terrestre – et en même temps elle devient en quelque sorte insignifiante pour le monde.
MOSAÏQUE

Les promesses bibliques concernent toujours la vie du PEUPLE. L’espérance chrétienne est aussi une espérance communautaire.
14° MOSAÏQUE – TOUS RESSUSCITES
La vie éternelle, la vie « en Dieu », est décrite comme le rassemblement de l’humanité autour d’un repas de noces, les noces de l’Agneau.
Vous pouvez lire le texte sur le pilier et écouter en cliquant ICI.
Dom Joseph Deschamps, Abbaye Notre Dame du Port du Salut
Cette lecture d’Isaïe nous parle d’un festin, du repas de noces de Dieu et de son peuple.
Les versets 1 à 5, qu’il est bon de lire, sont un cantique d’action de grâce pour la délivrance que Dieu vient d’opérer. L’écrasement de l’adversaire fait crier le peuple de joie : Dieu n’a pas oublié son peuple et au contraire il a été « son refuge pour le faible » qu’il était.
Le livre d’Isaïe fait partie d’un ensemble composites d’oracles et de poèmes dont la totalité n’est pas de la main d’Isaïe mais de disciples en qui on reconnaît son esprit. Isaïe s’adresse à Israël dans un langage faisant allusion aux derniers temps et de ce fait appelé « Apocalypse d’Isaïe ». La péricope de ce dimanche fait partie de ce qu’on appelle l’Apocalypse d’Isaïe (V° ou IV° siècle). Il pourrait avoir été rédigé soit après la prise de Babylone par Cyrus (539) ou après 485 lors d’une révolte de la ville.
Il s’agit d’un genre littéraire des périodes les plus sombres de l’histoire d’Israël : à cette époque selon le P. de Vaux » les croyances juives ne comportaient pas encore l’idée d’une résurrection des morts… mais au temps d’Isaïe déjà on imaginait la restauration nationale comme une résurrection. Cette littérature apocalyptique a pour but de relever l’espérance des croyants par l’annonce d’un grand festin de fête offert par « le Seigneur des armées » lui-même.
Selon Jules de Vaux : « il faut lire notre passage dans la perspective du jugement dernier : les ennemis du Seigneur sont irrémédiablement condamnés dans un fracas de fin du monde (Is 24, 18-22) tandis que le Règne des cieux commence à Jérusalem (25, 7-8) et que s’annonce la Résurrection générale (26, 19). C’est pour cela qu’éclatent des chants de joie et de louange à Dieu. »
L’action du Seigneur est annoncée par cinq verbes : le Seigneur préparera un festin de viandes et de vins, il détruira le voile qui voilait tout le peuple, il détruira la mort pour toujours, il essuiera les larmes de tous les visages, il ôtera l’opprobre de son peuple.
Le texte est apocalyptique, en ce sens qu’il dévoile le terme de la marche de l’histoire, et il a pour but de relever le courage et l’espérance des croyants du peuple de Dieu : il le détaille par ces cinq manifestations.
1 - « Le Seigneur préparera sur sa montagne un festin… » Le festin accompagnait les fêtes en l’honneur du Seigneur. L’auteur voit dans ce festin l’annonce de la fin de la misère d’Israël et de tous les peuples, le renversement de toutes les situations d’injustice, l’annonce du renouvellement de l’Alliance du Seigneur avec ceux qui ont persévéré dans l’espérance.
2 - « Le Seigneur fera disparaître le voile de deuil ». Le voile de deuil c’est toute la misère humaine des opprimés qui sera définitivement engloutie. Le voile enlevé permettra de voir la gloire du Seigneur.
3 - « Le Seigneur fera disparaître la mort pour toujours » : la mort, ce vieil ennemi de toujours de l’humanité. Il annonce le Ressuscité qui détruira la mort définitivement : 1 Co 15, 54-55 : « Quand donc cet être corruptible aura revêtu l’incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ? »
4 - « Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages » : détruire la mort et essuyer les larmes sont les deux termes repris dans l’Apocalypse pour marquer la nouveauté du monde qui vient ; Ap 21, 4 : « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. »
Pour les disciples de Jésus ce monde est déjà en train d’advenir.
5 - « Le Seigneur effacera l’humiliation de son peuple » : le peuple de Dieu retrouve toute sa dignité d’élu, de peuple choisi de Dieu.
Tous les peuples sont invités au festin, les frontières éclatent, le monde païen est à la fête ! Au moment de la rédaction de l’Apocalypse d’Isaïe les croyances juives ne parlaient pas encore d’une résurrection des morts. Ce n’est que beaucoup plus tard avec Daniel entre autres (vers 165) que cette croyance va s’affirmer. Mais déjà chez Isaïe la restauration nationale est envisagée comme une résurrection.
Ici, il s’agit d’un festin de fête où la qualité et la profusion seront présentes, fête à laquelle toutes les nations sont conviées. C’est la joie qui est exaltée parce que le salut est entré dans le monde nouveau où il n’y a plus ni deuil, ni larmes, ni mort.
L’Apocalypse de Jean redira dans des termes semblables : Ap 21, 2-4 « Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, comme une épouse qui s’est parée pour son époux. Et j’entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, La mort ne sera plus. Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. »
Cette description exaltante du festin messianique et de la Jérusalem céleste, basée sur la seule promesse du Seigneur, n’est-elle pas « trop belle pour être vraie » ? Ne s’agirait-il pas d’une projection mythique de nos aspirations humaines ? A cette sorte de tuberculose de la foi et de l’espérance, on peut répondre en montrant que notre foi au Dieu Sauveur ne repose pas sur un rêve, mais sur les interventions réelles de Dieu dans l’histoire, sur sa fidélité constante à ses promesses, sur la mort et la résurrection de Jésus Christ et sur son action présente dans l’Église et dans le monde. Cette espérance rejoint d’autre part les aspirations de tous les hommes fussent-ils incroyants : désir de justice des militants politiques, syndicaux et sociaux, lutte contre l’analphabétisme, la maladie et la mort menée par des enseignants, des médecins et des chercheurs, amour des mamans…
Pourquoi ces aspirations s’il n’y a pas un but à notre vie ? Quelqu’un à rencontrer : le Dieu Sauveur ? Ne soyons pas de ceux qui refusent l’invitation au banquet messianique adressée à tous les hommes, juifs, chrétiens ou incroyants.