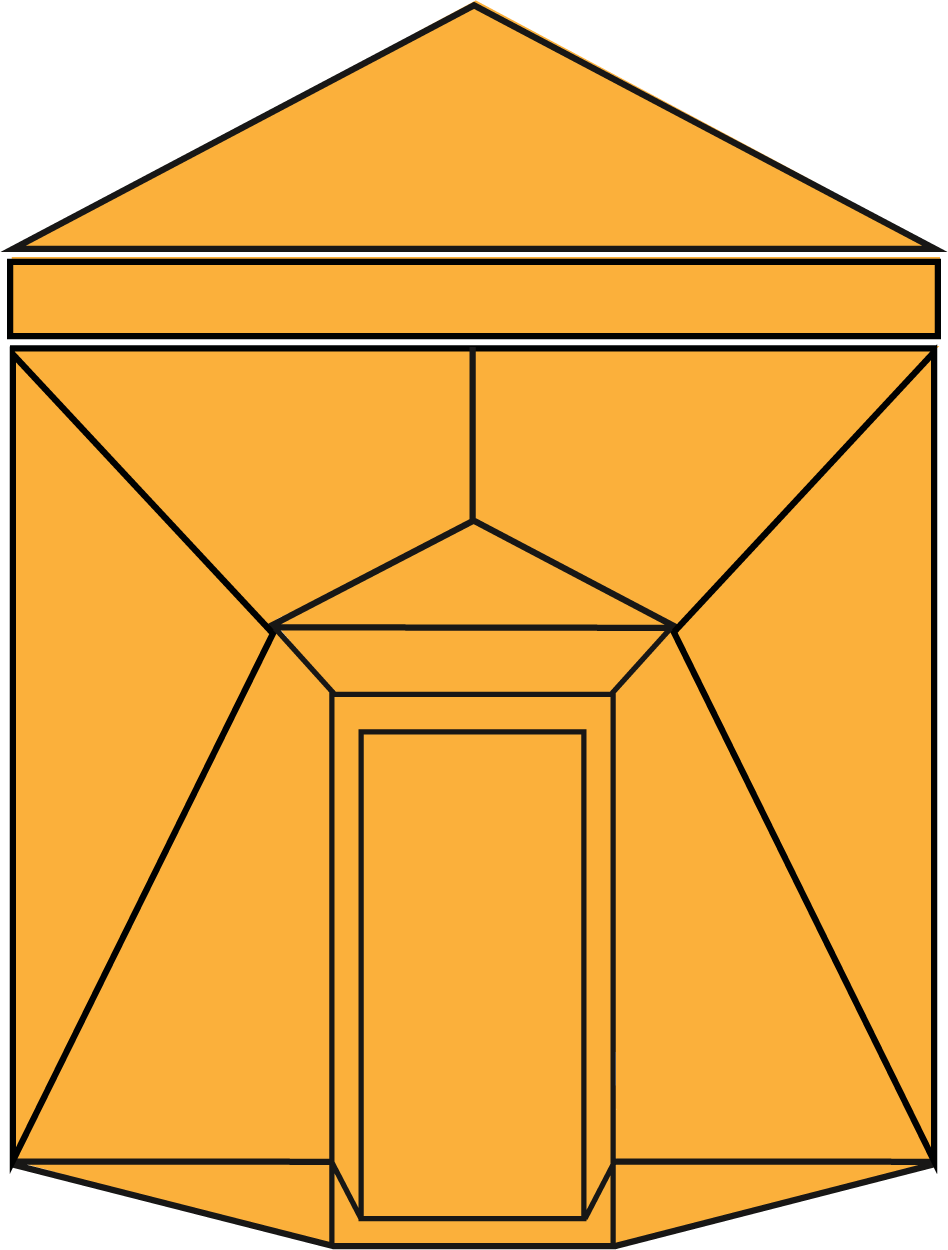Le Roi des arbres
‣ Méditation
Comme les arbres de la fable du livre des Juges, les grenouilles de La Fontaine réclament un roi. Quelle idée !! Et comme eux, elles obtiennent un mauvais roi. Non par ce que les bons ne se portent pas volontaires. Mais parce qu’elles elles trouvent trop mou celui qui est faible. De la difficulté de choisir un chef…
Les Grenouilles qui demandent un roi
Les grenouilles se lassant
De l'état démocratique,
Par leurs clameurs firent tant
Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique.
Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique :
Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant,
Que la gent marécageuse,
Gent fort sotte et fort peureuse,
S'alla cacher sous les eaux,
Dans les joncs, les roseaux,
Dans les trous du marécage,
Sans oser de longtemps regarder au visage
Celui qu'elles croyaient être un géant nouveau.
Or c'était un soliveau,
De qui la gravité fit peur à la première
Qui, de le voir s'aventurant,
Osa bien quitter sa tanière.
Elle approcha, mais en tremblant ;
Une autre la suivit, une autre en fit autant :
Il en vint une fourmilière ;
Et leur troupe à la fin se rendit familière
Jusqu'à sauter sur l'épaule du roi.
Le bon sire le souffre et se tient toujours coi.
Jupin en a bientôt la cervelle rompue :
« Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue. »
Le monarque des dieux leur envoie une grue,
Qui les croque, qui les tue,
Qui les gobe à son plaisir ;
Et grenouilles de se plaindre.
Et Jupin de leur dire :« Eh quoi ? votre désir
A ses lois croit-il nous astreindre ?
Vous avez dû premièrement
Garder votre gouvernement ;
Mais, ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire
Que votre premier roi fut débonnaire et doux
De celui-ci contentez-vous,
De peur d'en rencontrer
La Fontaine, Fables, livre III, 4, 1668
_________________________________
Dans cette petite tirade extraite du Misanthrope de Molière, Alceste, le misanthrope, montre tout ce que l’amour dévorant peut avoir de destructeur, quand il n’est que volonté de domination. D’ailleurs Célimène, à qui elle est adressée, en est effrayée.
ALCESTE
Ah ! rien n’est comparable à mon amour extrême ;
Et, dans l’ardeur qu’il a de se montrer à tous,
Il va jusqu’à former des souhaits contre vous.
Oui, je voudrais qu’aucun ne vous trouvât aimable,
Que vous fussiez réduite en un sort misérable,
Que le Ciel, en naissant, ne vous eût donné rien,
Que vous n’eussiez ni rang, ni naissance, ni bien,
Afin que, de mon cœur, l’éclatant sacrifice,
Vous pût, d’un pareil sort, réparer l’injustice :
Et que j’eusse la joie, et la gloire, en ce jour,
De vous voir tenir tout, des mains de mon amour.
Molière, Le Misanthrope, Acte IV, scène 3, 1666
_____________________________________________
Spinoza, Traité théologico-politique
Des fondements de l'Etat tels que nous les avons expliqués ci-dessus, il résulte avec la dernière évidence que sa fin dernière n'est pas la domination ; ce n'est pas pour tenir l'homme par la crainte et faire qu'il appartienne à un autre, que l'Etat est institué ; au contraire c'est pour libérer l'individu de la crainte, pour qu'il vive autant que possible en sécurité, c'est-à-dire conserve, aussi bien qu'il se pourra, sans dommage pour autrui, son droit naturel d'exister et d'agir. Non, je le répète, la fin de l'Etat n'est pas de faire passer les hommes de la condition d'êtres raisonnables à celle de bêtes brutes ou d'automates, mais au contraire il est institué pour que leur âme et leur corps s'acquittent en sûreté de toutes leurs fonctions, pour qu'eux-mêmes usent d'une Raison libre, pour qu'ils ne luttent point de haine, de colère ou de ruse, pour qu'ils se supportent sans malveillance les uns les autres. La fin de l'Etat est donc en réalité la liberté.
_________________________________
Paul Tillich, Le courage d’être
Il y a un moment où l’affirmation de soi de l’être humain normal présente des traits névrotiques : c’est lorsque la réalité avec laquelle il est en conformité se transforme et menace le courage fragmentaire par lequel il maîtrisait les objets habituels de crainte. Si cela arrive, et cela arrive souvent dans les périodes critiques de l’histoire, l’affirmation de soi devient pathologique. Les dangers qui accompagnent le changement, le caractère inconnu des choses qui arrivent, l’obscurité de l’avenir, tout cela contribue à faire de l’homme moyen un défenseur fanatique de l’ordre établi. Il le défend d’une façon tout aussi compulsive que le névrosé défend la forteresse de son monde imaginaire. Il perd sa relative ouverture à la réalité et il fait l’expérience d’une profondeur d’angoisse qu’il ignorait. Mais s’il ne réussit pas à intégrer cette angoisse dans son affirmation de soi, son angoisse tourne alors en névrose. C’est ce qui explique les innombrables névroses qui apparaissent lorsqu’une époque touche à sa fin.(…) L’angoisse existentielle du doute pousse la personne à se créer une certitude dans des systèmes de sens qui reposent sur la tradition et l’autorité.