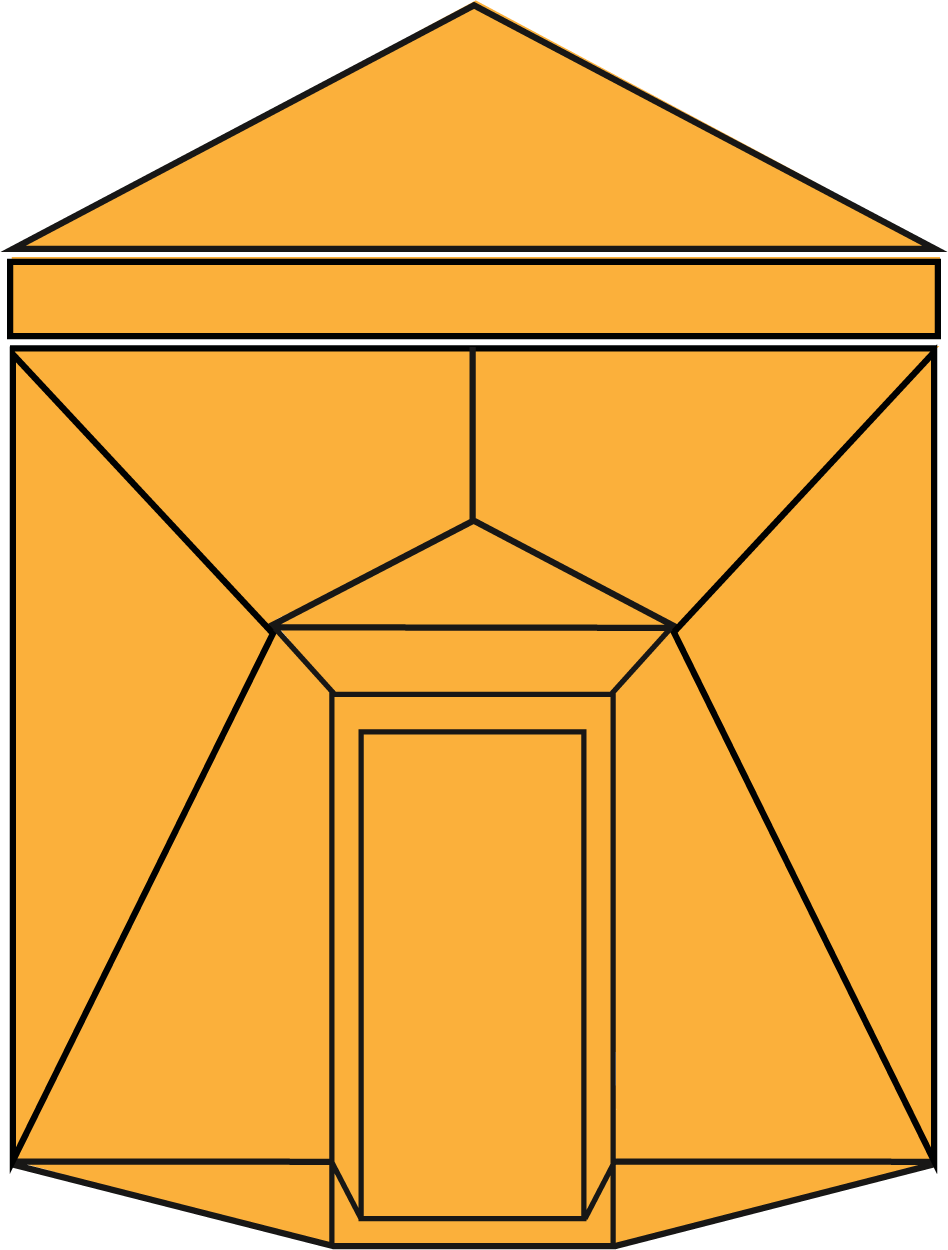Les paradoxes de la Terre promise
Katell Berthelot
La « Terre promise » n’existe pas. Du moins, l’expression en tant que telle n’apparaît nulle part dans les Écritures, et les appellations ô combien familières de nos jours de « Terre sainte » et de « terre d’Israël » sont rares. Bien que cette terminologie fasse défaut, la terre donnée par Dieu à Israël, désignée à l’origine comme « terre de Canaan », revêt une importance cruciale dans le Pentateuque et dans les livres dits « historiques » des Écritures. Avec la Torah, elle constitue l’un des deux piliers
de l’alliance entre Dieu et son peuple. Cette terre a un statut distinct, une forme de « sainteté », de-par le rapport particulier qu’elle entretient avec Dieu, comme le souligne Deutéronome 11,11-12 : « Le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est […] un pays dont l’Éternel, ton Dieu, prend soin [litt. : scrute, sonde], et sur lequel l’Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l’année. » C’est pourquoi certaines sources rabbiniques établiront par la suite un rapport d’analogie entre la terre choisie et élue par Dieu entre toutes, et le peuple choisi et élu par Dieu entre tous. Ce passage du Deutéronome contient comme le germe de la vision essentialiste et mystique de la terre d’Israël qui se développera par la suite dans certains courants du judaïsme, en particulier au Moyen Âge, par exemple chez Juda Hallévi (Kuzari II,10-24). Cependant le concept de Terre promise ou de terre d’Israël ne se développe pas de façon linéaire dans l’histoire de la pensée juive. Au moment du retour de l’Exil et durant la période du second Temple, les textes témoignent d’une focalisation sur le Temple et sur Jérusalem, et n’évoquent que rarement la terre et la promesse faite à Abraham. À l’inverse, il semble que la perte du Temple et de Jérusalem suite aux révoltes contre Rome de 66-73 et 132-135 ap. J.-C. ait paradoxalement contribué à revaloriser la terre comme élément de la relation entre Dieu et Israël, du moins dans les sources rabbiniques de Palestine. Le judaïsme babylonien, lui, conserve à la terre son importance biblique et son rôle eschatologique, mais ne l’exalte pas à la façon des sources palestiniennes. La Terre promise se dérobe en fait le plus souvent à la possession réelle, ce qui conduit à s’interroger sur la façon dont le don de la terre à Abraham et ses descendants fut compris par les générations successives, depuis la rédaction des livres bibliques jusqu’à leurs lointaines relectures talmudiques.
Le don de la terre par Dieu : à qui ? quand ? comment ?
La Bible hébraïque fait très fréquemment référence au don de la terre de Canaan à Abraham et à sa descendance. Pourtant, Abraham lui-même se désigne comme un étranger résident en Canaan (Genèse 23,4), et achète un terrain pour enterrer sa femme au prix d’une somme rondelette versée à Efrôn le Hittite. Le pays est d’ores et déjà donné par Dieu, mais pas encore effectivement possédé, car les Cananéens l’habitent encore. Genèse 15,16 explique que les descendants d’Abraham connaîtront l’exil et reviendront en terre de Canaan (sous-entendu : pour en prendre vraiment possession) quatre générations plus tard, car « l’iniquité des Amorites [une des peuplades de Canaan] n’est pas à son comble ». L’expression « Terre promise » renvoie donc au fait que le don à Abraham n’est pas immédiatement suivi de sa réalisation. De facto, la terre est davantage promise que donnée. En outre, la terre est donnée mais reste simultanément à conquérir, c’est une terre qu’il faut à la fois recevoir et prendre. Dieu annonce qu’il chassera les Cananéens devant les Israélites, mais selon d’autres textes et le récit du livre de Josué, les enfants d’Israël doivent combattre eux-mêmes pour entrer en possession de l’héritage promis. Cependant, si dans l’histoire de la pensée juive le don de la terre est perçu comme valable pour toutes les générations, le commandement de la conquête guerrière, lui, n’est pas nécessairement compris comme une obligation atemporelle ; certains sionistes religieux, au XXe siècle, établiront ainsi une différence nette entre l’obligation d’habiter le pays et celle de le conquérir par les armes, ne reconnaissant comme légitime que la négociation ou l’achat de terres.
Selon quelles frontières ?
La question de la réalisation de la promesse et de la possession du pays pose du même coup celle des frontières. Quelles sont les limites géographiques qui permettent de considérer la promesse comme accomplie ? La Bible hébraïque contient plusieurs conceptions des frontières de la Terre promise. D’après la plus répandue, le territoire s’étend « de Dan [au nord, au pied du mont Hermon] jusqu’à Beersheva [au sud, dans le Néguev] », tandis que la mer Méditerranée et le Jourdain constituent les frontières occidentale et orientale (1 Samuel 3,20 ; Nombres 33,50-51), laissant ainsi la rive orientale du Jourdain à l’extérieur de la Terre promise. Deux autres traditions conçoivent toutefois le territoire de manière plus étendue. La première, d’origine sacerdotale, se limite encore à la bande de terre allant de la Méditerranée au Jourdain, bornée par le torrent d’Égypte au sud ; mais la frontière nord est repoussée jusqu’à un lieu décrit comme « l’entrée de Hamath », au nord du Liban actuel (Nombres 34,1-12). Une autre tradition encore, que l’on peut qualifier de maximaliste et d’utopique, envisage un territoire allant du torrent d’Égypte (ou encore du Nil) jusqu’à l’Euphrate, en incluant une bonne partie du Liban et de la Syrie actuels, ainsi que la rive orientale du Jourdain (Genèse 15,18 ; Deutéronome 1,7 ou 11,24). Alors qu’à partir de la chute du royaume du Nord au VIIIe siècle, la terre habitée par les Israélites s’est généralement limitée à la Judée (selon des frontières elles-mêmes soumises à fluctuation), certains textes de la période du second Temple comme l’Apocryphe de la Genèse et le Livre des Jubilés (IIe siècle av. J.-C.) reproduisent la vision territoriale grandiose qui fait s’étendre le pays de l’Égypte à l’Euphrate. Dans la littérature rabbinique, à l’inverse, la terre d’Israël est plutôt définie en fonction de l’application de certaines lois agricoles, et délimitée selon un tracé inédit, qui établit la limite sud à Ashqelôn et la limite nord à Akko, par exemple. Selon la halakha rabbinique (lire p. 32-37), les frontières d’Eretz Israël incluent en fait les lieux où ceux qui revinrent de Babylone étaient censés s’être installés lors de leur retour à Sion. Fait significatif, la référence en matière de délimitation territoriale ne réside plus alors dans les promesses faites aux patriarches, mais dans la mémoire du retour de l’Exil, soit l’expérience de la perte de la terre et de la restauration.
À quelles conditions ?
L’historiographie biblique, de Josué à 2 Rois ou 2 Chroniques, peut être interprétée comme une tentative de rendre compte de la perte de la terre et du sanctuaire, expliquée par l’infidélité du peuple et surtout de ses dirigeants vis-à-vis de l’alliance conclue entre Dieu et Israël. Le caractère conditionnel de l’occupation de la Terre promise est donc présupposé à toutes les pages. Lors de la conquête par Josué, déjà, les Cananéens sont chassés et dépossédés à cause de leur « iniquité » ou de leurs « abominations » (Genèse 15,16 ; Lévitique 18), c’est-à-dire du fait d’une culpabilité d’ordre moral-religieux. Israël est explicitement prévenu qu’un sort similaire l’attend s’il ne respecte pas les commandements de l’alliance et se livre à l’idolâtrie et aux crimes qui lui sont traditionnellement associés (meurtres, adultères, vols, parjures…), ou encore oublie la justice sociale et néglige le shabbat. Pour l’exégète israélien Moshe Weinfeld, auteur d’un ouvrage incontournable sur la promesse de la terre et l’héritage du pays de Canaan par les Israélites, ce sont précisément les implications religieuses et éthiques de la présence en Canaan qui constituent la spécificité de la relation d’Israël avec la Terre promise. Selon lui, le caractère conditionnel de l’occupation du pays serait toutefois une idée tardive, postérieure à la chute du royaume du Nord ; les plus anciennes traditions (reflétées par exemple en Genèse 13,15 ; 17,8 ; Exode 32,13) véhiculeraient l’idée que le pays était donné pour toujours à Israël. Sur ce point son collègue hollandais Ed Noort va même plus loin. Pour lui, l’idée de conditionnalité serait plus récente encore, et ne remonterait qu’aux auteurs deutéronomistes tardifs, post-exiliques. À partir de l’époque du second Temple, en tout cas, la vision deutéronomiste est bien enracinée : la perte de la terre représente une éventualité très réelle dans les esprits, tout comme son corollaire, la possibilité de la restauration nationale et territoriale.
Un droit de propriété pour Israël ?
Si le don divin ne garantit pas la jouissance effective de la possession de la terre, établit-il en revanche un droit de propriété inaliénable pour Israël vis-à-vis des autres peuples ? Notons tout d’abord l’insistance paradoxale, dans les Écritures, sur l’origine non-autochtone des Hébreux. La terre de Canaan n’est pas présentée comme la patrie du peuple d’Israël, ni comme celle de son ancêtre Abraham. Ce dernier est en quelque sorte un exilé en Canaan, ou du moins un immigré. De droit du sol, il ne saurait être question. En outre, la liste des territoires des nations en Genèse 10 laisse entendre que les Cananéens sont légitimement établis en Canaan, ce que suggère aussi la désignation même du pays comme « terre de Canaan ». Sur ce point, certaines sources juives de la période du second Temple proposent une relecture radicale, qui sera reprise par la suite dans la littérature rabbinique. D’après le Livre des Jubilés, lors du partage des terres entre les fils de Noé, le pays de Canaan faisait en réalité partie du lot de Shem, et devait revenir à ses descendants israélites par droit d’héritage. Canaan et ses descendants se l’approprièrent de force et encoururent la malédiction correspondante. L’insistance nouvelle sur un droit de propriété originel (anté-abrahamique !) transmis par héritage, justifiant une conquête postérieure, s’explique probablement par le contexte hellénistique de la rédaction des Jubilés ; l’argument est en effet récurrent dans les inscriptions et les textes littéraires hellénistiques traitant de conflits territoriaux. Il est également utilisé par l’Asmonéen Simon lors du conflit avec le roi séleucide Antiochos VII à propos de certains territoires de la Judée (1 Maccabées 15,33-34). Cette juridicisation du rapport à la terre se retrouve par la suite dans plusieurs sources rabbiniques. Dans le Sifra, un commentaire du Lévitique du IIIe siècle ap. J.-C., le peuple d’Israël reproche à Dieu de lui avoir donné une terre qui appartenait déjà à un autre peuple ; sans se démonter, Dieu rétorque qu’elle était dès l’origine la propriété d’Israël comme descendant de Shem, et que les Cananéens ne firent que servir de gardiens des lieux jusqu’à l’arrivée d’Israël…
Les paradoxes attachés à la notion de Terre promise sont donc nombreux, qu’il s’agisse de l’incertitude sur la temporalité de la promesse, déjà accomplie ou encore en devenir, de la tension liée à la présence d’autres peuples dans le pays donné en héritage, ou encore du contraste entre l’affirmation du caractère inaliénable du don et la réalité des invasions étrangères et de la perte répétée de souveraineté.
mondedelabible.com/les-paradoxes-de-la-terre-promise/