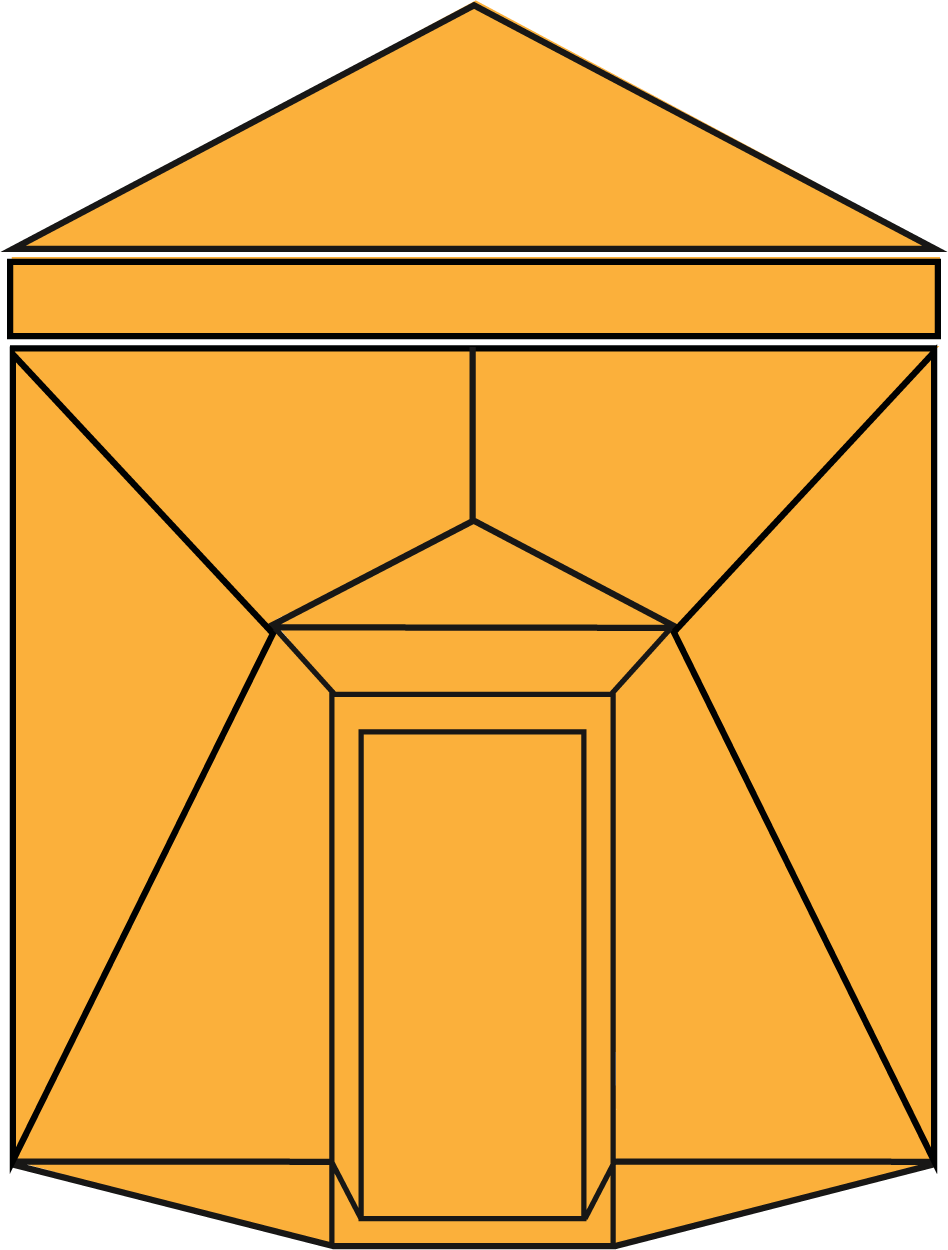1 : Dans l'Espérance, nous avons été sauvés.
Romains 8, 24 : Nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment peut-on l’espérer encore ?
Spe Salvi
1. « Spe salvi facti sumus » – dans l'espérance nous avons été sauvés, dit saint Paul aux Romains et à nous aussi (Rm 8, 24). Une question s'impose immédiatement : mais de quel genre d'espérance s'agit-il pour pouvoir justifier l'affirmation selon laquelle, à partir d'elle, et simplement parce qu'elle existe, nous sommes rachetés ? Et de quel genre de certitude est-il question ?
Mosaïque
En introduction de notre parcours, il est bon de nous poser la question : Qu'est-ce que le SALUT ?
Le salut est un thème central dans le christianisme. Pourtant le mot, quelque peu désuet, nous est moins familier que le verbe « sauver ». Lorsqu’un proche nous offre une solution inattendue à une situation apparemment sans issue, ne dit-on pas couramment : « Tu me sauves ! » Mais dès lors que l’on évoque le Christ sauveur, que l’on affirme que le Christ nous apporte le salut, les choses sont nettement moins claires, et l’interrogation de notre internaute rejoint l’incompréhension de nombreux contemporains devant cette notion spirituelle pourtant présente dans plusieurs traditions religieuses.
Le salut, signe de libération
On trouve le salut dans la Bible bien avant la naissance de Jésus. Évoqué dans les Psaumes comme un appel à l’aide personnel, il est aussi l’espérance de tout un peuple en captivité. Dans l’Ancien Testament, Dieu sauve son peuple de l’esclavage. Aussi Moïse et la sortie d’Égypte sont-ils pour Israël « la » référence du salut : « N’ayez pas peur ! Tenez bon ! Et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd’hui » (Exode 14, 13).
Par la suite, tous les prophètes annonceront le salut : « Voici ton salut qui vient » (Isaïe 62, 11). Et ce salut qui vient n’est autre que Jésus, dont le nom même signifie « Dieu sauve » et qui, tout au long de sa vie publique, promettra le salut à ceux qui le suivront.
Sauvés de quoi ?
Pourquoi avons-nous besoin d’être sauvés ? « Il suffit de regarder autour de soi, explique le théologien Bernard Sesboüé, nous sommes habités par un désir profond et exigeant de bonheur qui durerait toujours et par le besoin incoercible d’aimer et d’être aimé. Mais ce bonheur parfait nous ne pouvons l’atteindre par nos propres moyens ! Nous avons donc besoin d’être arrachés à notre insatisfaction, à notre manque de bonheur. Autrement dit, nous sommes habités par un désir de salut. »
« Nous ne sommes donc pas sauvés par la mort de Jésus, mais par son amour manifesté dans tout ce qu’il a vécu tout au long de sa vie, par ses gestes, ses paroles, ses actes » affirme Bernard Sesboüé. Le salut est un acte gratuit de Dieu qui vient nous transformer et nous libérer. « Jésus se présente à nous comme le Sauveur en se montrant tout simplement comme l’homme sauvé », poursuit le théologien.
La vie de Jésus est tout entière une vie qui sauve
Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus montre que l’amour est victorieux du mal, de la souffrance et de la mort. C’est par l’Incarnation que Dieu sauve et guérit toutes les misères de l’humanité.
Pour les contemporains de Jésus, la maladie et le handicap étaient le châtiment d’un péché. Les évangélistes donnent le titre de « Sauveur » à Jésus ressuscité, parce qu’ils font le lien entre sa résurrection et tous les gestes « sauveurs » qu’il a accompli au cours de sa vie publique comme le pardon à Zachée, la guérison du paralytique ou encore la résurrection de Lazare. Ces gestes sont à l’origine de ce que l’Église instituera dans ses futurs sacrements, où le geste s’allie à la parole pour exprimer le salut.
« Mais Jésus n’est pas venu simplement faire des miracles, et sauver tous les hommes. Il est venu sauver “tout l’homme” pour le réhabiliter dans le dessein de Dieu », commente le P. Sesboüé. « Jésus par sa résurrection donne l’exemple, réalisé déjà en lui, de ce qui nous est promis, du salut auquel nous sommes invités. Tel il est ressuscité, tel nous ressusciterons. Par conséquent, la résurrection de Jésus ne peut pas rester seule, c’est une résurrection pour nous. »
La passion de Dieu pour l’homme
En quoi la résurrection du Christ nous sauve-t-elle ? « Jésus, en allant jusqu’au don de sa vie sur la croix, nous révèle la passion de Dieu pour l’homme. Il nous révèle que nous ne trouverons notre accomplissement parfait que dans l’accueil de l’Amour créateur de son Père », écrit Bernard Sesboüé. Pour ceux qui croient, il y a donc bien un lien entre nos souffrances, notre espérance d’une vie meilleure inscrite au plus profond de nous, et la résurrection du Christ. Et le théologien poursuit : « Même si nous n’avions pas péché, l’homme serait en besoin radical de salut par rapport à Dieu. » Car le projet de salut de Dieu qui est de vouloir que l’homme participe à la vie divine est plus ancien que le péché. Nous avons donc besoin d’être sauvés de tout ce qui fait obstacle à cette « divinisation ».
Le jésuite Henri de Lubac fut un des premiers dans les années 1950 à affirmer le besoin radical de salut : « L’homme est un être limité qui a pour vocation de participer à l’absolu. »
À sa suite, le P. Sesboué affirme : « Être sauvé, c’est vivre, vivre tout entier, vivre absolument, vivre toujours, vivre dans l’amour reçu et communiqué, dans une réconciliation définitive avec nous-mêmes, avec les autres, avec l’univers et avec Dieu. »
Des résurrections anticipées
Le salut c’est la résurrection de Jésus qui nous délivre de la mort. Mais, écrit Bernard Sesboüé, « le salut ne concerne pas que l’après-mort ». Depuis que Jésus s’est incarné, le salut est à portée de nos mains. Il nous est offert en permanence par Jésus comme à Zachée : « Aujourd’hui le salut est venu dans ta maison » (Luc 19, 9). Mais si le salut est gratuit et offert à tous les hommes, il n’est pas pour autant automatique. Tout homme peut être sauvé, mais il est demandé à chacun une adhésion personnelle, un acte de foi. C’est en cela que nous sommes libres. Libres d’accepter ou de refuser : « Celui qui t’a créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi », disait saint Augustin.
Selon Bernard Sesboüé, « l’histoire humaine est ce long passage du salut qui sera achevé à la fin des temps ». Le salut est donc bien une réalité dans nos vies. Certains vivent même des « résurrections anticipées » qui résultent d’hommes et de femmes qui, par le don d’eux-mêmes, créent sur terre les conditions pour que les gens se libèrent de leurs chaînes, trouvent la réconciliation avec eux-mêmes, l’accueil aux autres, l’ouverture à Dieu.

6° MOSAÏQUE – CANA
Premier "signe" de Jésus qui manifeste que le Royaume est présent parmi nous, que le Salut est au rendez-vous de l'histoire humaine. Notre humanité "en manque" est comblée par la présence agissante du Christ : le vin coule en abondance !
L'espérance et la confiance amoureuses des époux le jour de leur mariage deviennent le signe de notre espérance et de notre confiance en Dieu.
Vous pouvez lire le texte sur le pilier et écouter en cliquant ICI.
Charles Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu, 1912 (extrait)
La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance…
La petite espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs et on ne prend pas seulement garde à elle.
Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route
interminable, sur la route entre ses deux sœurs la petite espérance
S'avance.
Entre ses deux grandes sœurs.
Celle qui est mariée.
Et celle qui est mère.
Et l'on n'a d'attention, le peuple chrétien n'a d'attention que pour les deux grandes sœurs.
La première et la dernière.
Qui vont au plus pressé.
Au temps présent.
À l'instant momentané qui passe.
Le peuple chrétien ne voit que les deux grandes sœurs,
n'a de regard que pour les deux grandes sœurs.
Celle qui est à droite et celle qui est à gauche.
Et il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu.
La petite, celle qui va encore à l'école.
Et qui marche.
Perdue entre les jupes de ses sœurs.
Et il croit volontiers que ce sont les deux grandes qui traînent la petite par la main.
Au milieu.
Entre les deux.
Pour lui faire faire ce chemin raboteux du salut.
Les aveugles qui ne voient pas au contraire.
Que c'est elle au milieu qui entraîne ses grandes sœurs.
Et que sans elle elles ne seraient rien.
Que deux femmes déjà âgées.
Deux femmes d'un certain âge.
Fripées par la vie.
C'est elle, cette petite, qui entraîne tout.
Car la Foi ne voit que ce qui est.
Et elle elle voit ce qui sera.
La Charité n'aime que ce qui est.
Et elle elle aime ce qui sera.
La Foi voit ce qui est.
Dans le Temps et dans l'Éternité.
L'Espérance voit ce qui sera.
Dans le temps et dans l'éternité.
Pour ainsi dire le futur de l'éternité même.
La Charité aime ce qui est.
Dans le Temps et dans l'Éternité.
Dieu et le prochain.
Comme la Foi voit.
Dieu et la création.
Mais l'Espérance aime ce qui sera.
Dans le temps et dans l'éternité.
Pour ainsi dire dans le futur de l'éternité.
L'Espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera.
Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera
Dans le futur du temps et de l'éternité.
Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé.
Sur la route montante.
Traînée, pendue aux bras de ses deux grandes sœurs,
Qui la tiennent pas la main,
La petite espérance.
S'avance.
Et au milieu entre ses deux grandes sœurs elle a l'air de se laisser traîner.
Comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher.
Et qu'on traînerait sur cette route malgré elle.
Et en réalité c'est elle qui fait marcher les deux autres.
Et qui les traîne.
Et qui fait marcher tout le monde.
Et qui le traîne.
Car on ne travaille jamais que pour les enfants.
Et les deux grandes ne marchent que pour la petite.