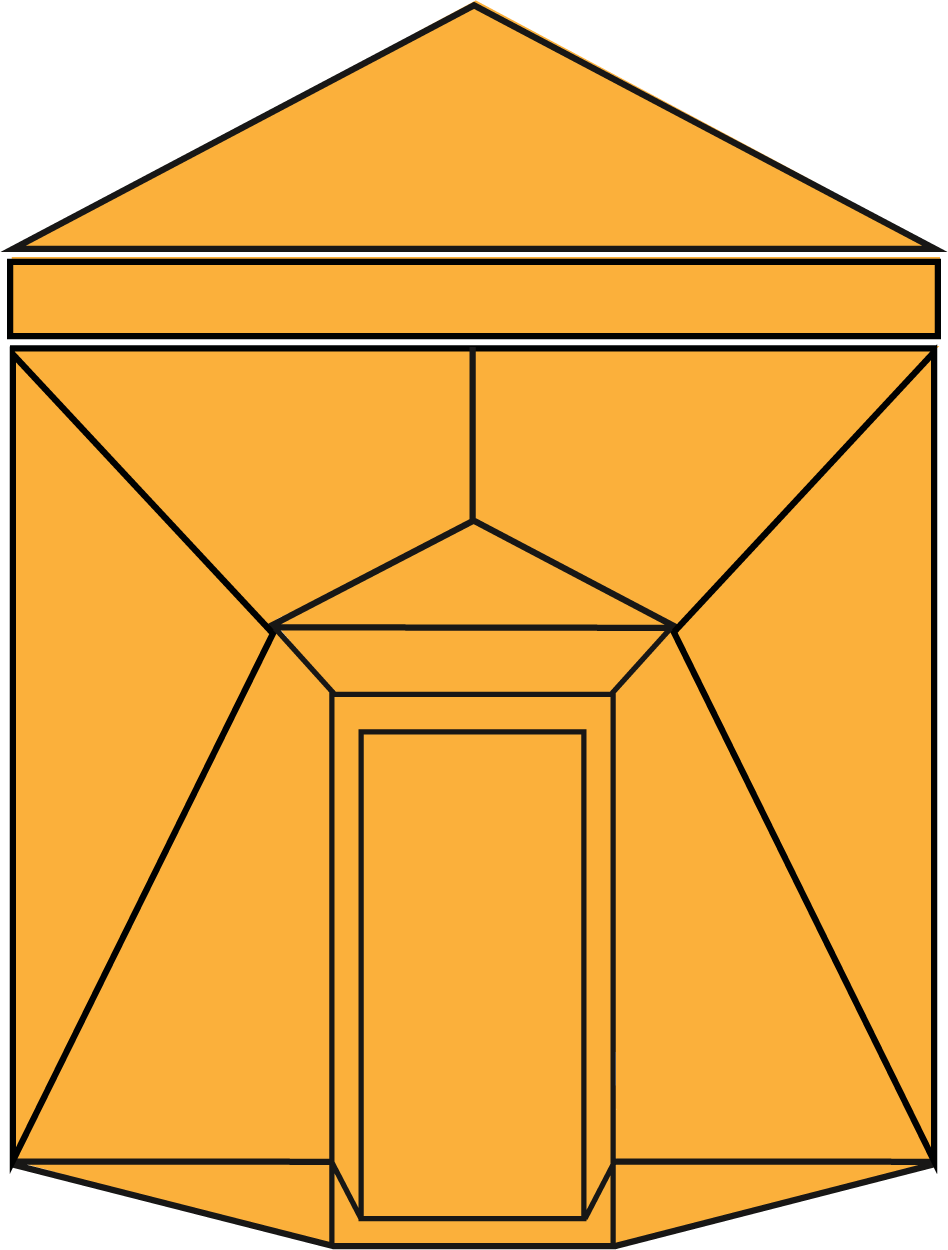1: Notre Dame de la Fin des Terres
La basilique, située à Soulac, à une centaine de mètres de la plage, est ici l’édifice le plus occidental, et aussi le plus septentrional du diocèse. Son portail fait face à l’océan dans un prolongement parfait, comme pour laisser réchauffer la nef des derniers rayons de soleil de chaque journée.
La proximité de l’océan donne l’impression que l’église s’en extirpe à chaque marée, comme une Atlantide sans cesse retrouvée, et qu’elle protège les hommes et les terres qui s’étendent derrière elle des monstres marins qu’on imaginait peupler les inquiétant abysses.
La façade est ici décrite par une sélection d’éléments architectoniques reproduits en fidèles proportions.
Le Léviathan est décrit comme une ombre insaisissable dont le corps, par le jeu des réserves et de la gravure, semble se mêler aux flots jusqu’à affleurer le parvis de la basilique.
2: Saint Pierre de Vertheuil
Une série d’allusions graphiques permettent d’identifier l’ensemble du site formé de l’abbaye et de l’église de Vertheuil
On peut reconnaître le musicien qui trône en clé de voûte décorée du du bas-relief ornant la voussure du porche roman du XIIème siècle.
Les deux tours visibles à la base sont le clocher Nord, du XIIème, et le clocher Sud, daté, lui du XVIème siècle, conservé ici dans un soucis d’identification.
L’encorbellement de style gothique qui orne la tribune d’orgue est découpé dans l’angle haut gauche, en dessous figure un des cul-de-lampe les plus célèbres de l’église, qui illustre le péché de bestialité.
Les inscriptions gravées sont celles de la croix de cimetière posée sur la place au XVIème siècle mais dont la pierre inscrite serait un réemploi d’une pierre plus ancienne.
3: Saint Seurin
L’hommage à la plus vieille église de Bordeaux se dévoile dans un théâtre de l’ambigüité.
L’église était alors aux portes de la ville. Les vignes et les chemins la bordaient.
Ainsi, entre ville et campagne, entre chien et loup, la danse des trois lunes qui se succèdent (celles de Bordeaux, bien-sûr) semble éclairer ce vigneron attardé qui se hâte, inquiet, alors que surgit un personnage inquiétant, dont la nature double exprime l’incertitude qui peut surgir lorsque l’on croise à ces moments un inconnu. Une inquiétude à la fois urbaine et moyenâgeuse, intemporelle.
4: Sainte Praxède de Sauviac
Ne reste de la chapelle du XIIème siècle que la façade ornée modillons à l’expression mystérieuse, et son clocher-mur, représenté ici en encadrement de la scène relative à Sainte Praxède. Celle-ci transforma son palais en Eglise afin d’y accueillir les chrétiens. Issue de la noblesse romaine, elle jouissait ainsi d’une certaine protection qui dura tant qu’Antonin, dit Le Pieux, resta empereur. A sa mort de ce dernier son successeur Marc Aurèle appliquera la persécution des chrétiens avec moins de souplesse.
Ainsi, lors de l’épisode décrit ici, Marc Aurèle décide de l’exécution des chrétiens mais laisse Praxède indemne. Cette dernière demande alors des comptes à Dieu sur cette survie. En était-elle digne? Pourquoi n’avait-elle pas été rappelée à lui comme les autres?
L’aspect théâtralement apocalyptique du massacre des chrétiens est ici comme une représentation historique du mépris stoïcien qu’éprouvait Aurèle envers la fierté que retiraient les martyrs de leur sacrifice.
«Qu’il soit raisonné, grave, et, si tu veux qu’on te croie, sans pose tragique.» (Pensées pour moi-même).
5 : Prieuré de Cayac
De l’ancien hospital qui accueillait les pèlerins en route vers Saint-Jacques de Compostelle ne subsiste que ce morceau du prieuré devant lequel passe encore la via Turonensis, chemin des pèlerins venus du Nord de la France.
C’est ce pèlerinage qui est figuré ici. En témoignent la grande coquille de style art-déco gravée, le chemin qui descend, avec son nom inscrit en partie en écriture stéréoscopique. Un pèlerin dans sa représentation moyenâgeuse classique est en marche vers le sud.
6 : Le RIvet et les Antonins.
Ce laiton évoque par la présence importante du Tau découpé en son centre l’ordre de Saint Antoine, présent à Pondaurat, et dans son voisinage une des plus vieilles abbayes de France ; L’abbaye du Rivet.
Les Antonins s’étaient fait une spécialité de soigner les malades atteints du Feu de Saint Antoine - appelé aussi mal des ardents - qui n’est autre que l’ergotisme.
La maladie est ici illustrée par un esprit mystérieux qui hante les vignes, mais aussi et de façon plus prosaïque par un épi de seigle dont on voit le champignon néfaste pendant à la tige, sombre volute accroché à sa base.
Au-dessus un homme visiblement en proie à de violentes perturbations chevauche un animal étrange.
Ce cortège incarne l’entité désordonnée et indissociable que forment deux éléments, distincts, opposés, la maladie et son hôte, mais liés par le destin et projetés dans une course en avant vers une funeste conclusion.
7 : Saint Martin
La petite église de Saint Martin n’est pas une «star» des médiévistes. Mais elle est là, signalée par un petit panneau en bord de route, toujours paisiblement installée au cœur du vignoble de l’Entre-deux-mers. C’est ainsi depuis longtemps ! En témoignent ses chapiteaux ornés de nombreuses scènes autour de la vigne, dont ces truculentes grives piquant dans des grappes généreuses reproduites ici. Curieusement, par leurs arrondis besogneux, elle évoquent les contours heurtés des mosaïques romaines…
Justement, Saint Martin était légionnaire quand il reçut l’appellation de miséricordieux, lors de l’épisode dit du partage du manteau avec un mendiant. Il est donc représenté ici sans manteau, découpé dans un espace où se côtoient le monde romain et l’univers chrétien. Le portail de l’église représenté fidèlement dans son heure d’occident, en symbolise la solide et accueillante entrée. Saint Martin est représenté à la jonction de ces deux mondes, tournant le dos au temple, et s’appuyant sur le portail de l’église, il se prépare à y accueillir un pauvre ère et un enfant.
8 : Saint Maurice de Blasimon
Ce sont les ruines de l’antique abbaye qui sont ici découpées, faisant office de socle à ce buste découpé de Saint Maurice, fidèle adaptation de la sculpture de la cathédrale de Magdeburg en Allemagne. Cette sculpture datée du XIIème siècle représente avec force le visage du saint kabyle, la côte de maille mettant en valeur la puissance de ses traits négroïdes. Autour, la Sainte Lance qu’il aurait ramené d’Egypte (les versions diffèrent) forme un décors Art-déco avec les deux aigles, symbole de l’Autriche dont Maurice d’Agone est le saint Patron. Maurice, ainsi que la lance sont par tradition historique associés à l’histoire de l’Empire Romain Germanique.
9: Saint Emilion
Lorsqu’on se rend à Saint Emilion, les occasions de s’extasier ne manquent pas, mais si on sort des sentiers (re)battus on finit par rencontrer ce qui reste des majestueuses murailles qui abritaient la ville au Moyen-âge. Il en reste un pan, et dans ce pan, un trou. Il est fidèlement représenté ici, jusqu’aux corbeaux qui se perchent sur sa travée pour scruter les vignes millénaires des millionnaires.
10: Saint Felix de Cazelle
Autour de Saint Félix, l’histoire a partout laissé sa marque.
D’abord la chapelle de Lurzine dont ne subsiste que cette belle abside qui trône encore au milieu des vignes. L’iconographie des modillons témoigne de la riche histoire viticole de ce site. Faisant désormais office de caveau funéraire, autour d’elle les croix du cimetière se mélangent et se perdent dans le lointain avec les ceps des vigne qui la cernent.
Tout se déroule ici sous le regard de Lucine, déesse de la lumière. Le temple qui lui était dédié a cédé ses pierres à la Chapelle, qui a gardé dans son nom la mémoire de l’antique divinité.
Enfin, tout à côté, à Prignac-et-marcamps les grottes de Pair-non-pair abritent les gravures qui viennent se superposer dans le décors comme pour compléter une chronologie archéologique de cet endroit qui semble sacré depuis la nuit des temps.
11: Saint Vincent
L‘Eglise de Saint Vincent de Villeneuve aurait-elle pu accueillir, en dehors d’une forte activité viticole, les reliques de Saint Vincent de Saragosse?
Les épisodes de la vie et du supplice de Vincent sont nombreux et pour le moins confus. Il a donc été tentant de se livrer ici à ce qu’on appelle parfois une «lecture hallucinée», ou encore une représentation mélangeant de façon un peu confuse, mais marquante, divers éléments de l’historiographie d’un saint ; en proposant ainsi une nouvelle.
Ici, nous retrouvons donc pèle-mêle divers éléments narratifs ou iconographiques classiques, tels la pierre de meule attachée à son cou pour une noyade, son corps livré aux bêtes sauvages mais sauvé par des corbeaux, ou un loup, et le morceau de la Croix.
Enfin sa propension à s’extirper des eaux et à avoir été aperçu sur de nombreux rivages aura inspiré ce périple maritime qui l’aurait mené de Saragosse, en Espagne, dont on reconnait la silhouette de la cathédrale, à Saint Vincent où il aurait certainement été accueilli comme le Saint protecteur de la vigne qu’il est pour nous.
12: Sainte Madeleine de Pleine Selve
L’église abbatiale des prémontrés a disparu, néanmoins, sur la façade occidentale de l’actuel édifice on peut distinguer les traces du pendentif qui supportait l’ancienne coupole de la première travée de la nef.
Un beau décors romantique pour une Madeleine ici représentée par ses attributs classiques, cheveux défaits et visage fardé.
C’est à la tradition tardive des représentations qu’elle emprunte le miroir de courtisane et la tête de mort à ses pieds, ce qui l’identifie à la courtisane apaisée, dans sa période méditative.
Le passage sous l’arc décoré de croisillons, un motif présent un peu partout sur l’église, indique sa «sortie», alors qu’elle prépare sa retraite méditative.
La répétition régulière du méandre sur toute sa surface, associé à ses proportions hautes et solides, fait ressembler la plaque entière à une tour carrée.
Ce motif rappelle en outre les origines orientales de la sainte dont le nom signifierait une tour.
La gravure de vagues et de sillons mêlés évoque la position géographique particulière, entre vignes et mer, de l’édifice.
13: La Sauve Majeure.
Pour les archéologues, les médiévistes, les touristes, elle est la «star», sans conteste, de la région ; et c’est à raison.
Elle est si richement constituée et si documentée qu’on pourrait sur ce modèle lui consacrer une église entière pour décrire ses trésors.
Ici c’est juste la tour clocher qui a été choisie. On la voit de loin, et de partout, dominant de sa majesté, tel un phare pour l’âme, la mer de vigne qui l’entoure.
Elle est simplement entourée d’un halo de gravures représentant des vignes, une grappe, et un des chapiteaux garni de grappes, soulignant là encore le lien charnel, taillé dans la pierre, qui unit la culture du vin et l’architecture religieuse de tout le Moyen-âge (l’Abbaye se situant à la croisée des périodes).
14: Sainte Croix.
Située à l’époque aux faubourgs de la cité, entourée de marécages, elle devait faire un effet magnifique et étrange, semblant un immense vaisseau sortant des brumes profanes du cloaque.
Sa façade, restaurée à l’identique malgré l’ajout d’une large tour, est toujours imposante dans sa rigueur architectonique saintongeaise qui met en valeur le riche décorum.
Dans cette noble organisation visuelle se nichent les nombreux bas-reliefs indiquant la présence d’activités viticoles, représentées avec d’autres métiers, au milieu des thèmes liturgiques ou bibliques.
Mais c’est à la statue magnifique de Saint Georges terrassant le dragon que la plaque fait la part belle.
Un fantastique combat entre le bien et le mal se déroule ici (en) bas, et des sortes de griffures explosent dans un chaos qui cependant ne fait qu’effleurer l’église.
Lumineuse et triomphante, répondant aux cieux, la façade s’extirpe avec force de l’ombre envahissante.
Attention cependant à cette sournoise virgule ; la queue du dragon qui semblait vouloir s’échapper discrètement du combat, mais semble vouloir revenir dans l’ombre…
L’ombre froide de Février, sûrement.
iconographie